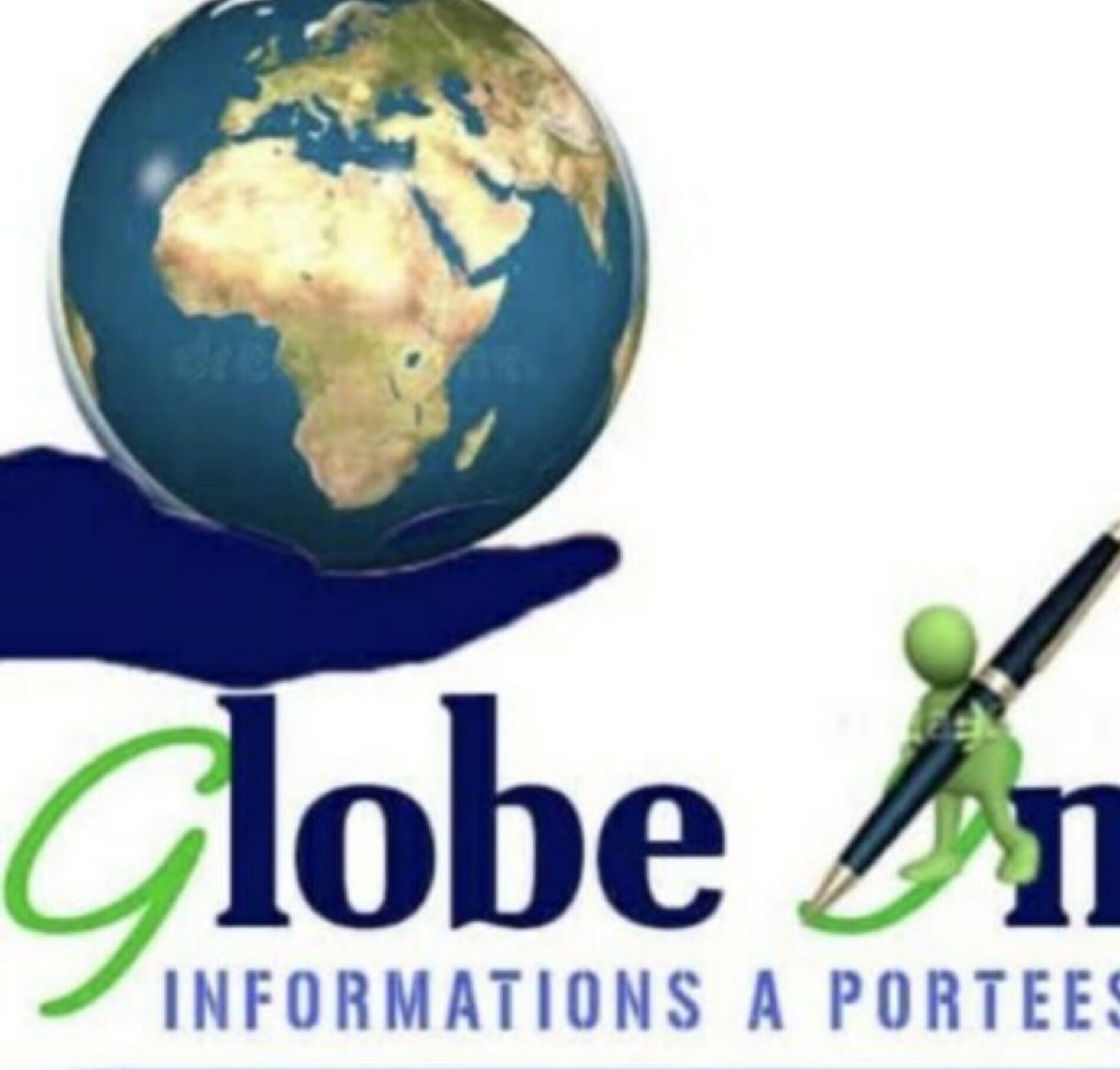Par Thomas René
L’arrestation au Liban de Nazih Marwan Al-Azzi, activiste gabono-libanais aux discours controversés, soulève des questions de fond sur la confusion entre influenceurs numériques, activistes et professionnels de la communication. Alors que certains autoproclamés « créateurs de contenus » s’arrogent une place au sein de dispositifs officiels, cette affaire relance le débat sur la nécessité de structurer le secteur et de réserver l’espace institutionnel aux véritables professionnels.

En effet, l’arrestation récente de l’activiste gabono-libanais Nazih Marwan Al-Azzi, interpellé au Liban après avoir quitté précipitamment le territoire national, marque un tournant dans les rapports entre liberté d’expression, responsabilité citoyenne et coopération judiciaire internationale. Ce dossier à haute sensibilité met également en lumière un enjeu de fond : la confusion croissante entre activisme numérique et professionnalisme en communication.
Nazih, 25 ans, s’était érigé ces derniers mois en pourfendeur virulent du système via les réseaux sociaux, où ses publications se voulaient subversives, parfois outrancières, sans vérification, sans cadre, ni respect des institutions. Présenté comme un « créateur de contenus » autoproclamé, il s’était aussi aventuré à prétendre détenir des informations compromettantes pour la stabilité du pays. Depuis le Liban, il continuait à relayer ses messages, alimentant tensions et désinformations, jusqu’à son interpellation le 2 août 2025, fruit d’une coopération bilatérale saluée entre Libreville et Beyrouth.
Mais l’affaire Nazih dépasse la simple trajectoire d’un individu. Elle révèle une dérive silencieuse mais préoccupante dans l’espace médiatique national : celle d’un amalgame entre les professionnels de la communication journalistes formés, communicants institutionnels, agents de presse accrédités et un foisonnement d’acteurs informels, activistes numériques ou influenceurs auto-institués. Ces derniers, souvent sans aucune formation ni adhésion aux codes déontologiques du métier, occupent désormais des espaces autrefois réservés à ceux qui incarnent la rigueur, la responsabilité et l’engagement au service de l’intérêt public.
On les retrouve parfois conviés à des rencontres officielles, placés à côté de journalistes chevronnés ou de responsables d’organes reconnus. Une confusion qui porte atteinte à la crédibilité du secteur et brouille les canaux de transmission de l’information fiable. Car informer, ce n’est pas séduire. Ce n’est pas crier plus fort que les autres. Informer, c’est vérifier, contextualiser, équilibrer, et surtout, assumer une responsabilité vis-à-vis de la société.
La communication publique, en particulier lorsqu’elle concerne les institutions républicaines, dont la Présidence de la République, ne saurait être laissée à des mains inexpertes ou animées par des agendas personnels. Le Chef de l’État, incarnation de la souveraineté nationale, ne doit être promu, relayé ou interprété que par des professionnels dûment habilités, capables de porter le message présidentiel avec gravité, fidélité et discernement.
L’heure est peut-être venue de structurer davantage ce secteur en pleine mutation. Pourquoi ne pas envisager un statut clair pour les créateurs de contenus, influenceurs ou blogueurs, distinct de celui des journalistes ou communicants professionnels ? Un cadre réglementaire et éthique pourrait permettre à chacun d’exister selon ses compétences, tout en préservant la qualité de l’information et le respect des institutions.
L’arrestation de Nazih n’est pas une victoire contre un homme, mais un signal pour un pays. Un appel au retour de l’ordre dans le secteur de la communication. Un rappel que la liberté d’expression n’est jamais un permis d’anarchie. Et une invitation, enfin, à réaffirmer que la parole publique mérite mieux que la clameur des réseaux. Aujourd’hui Nazih. Et demain ?