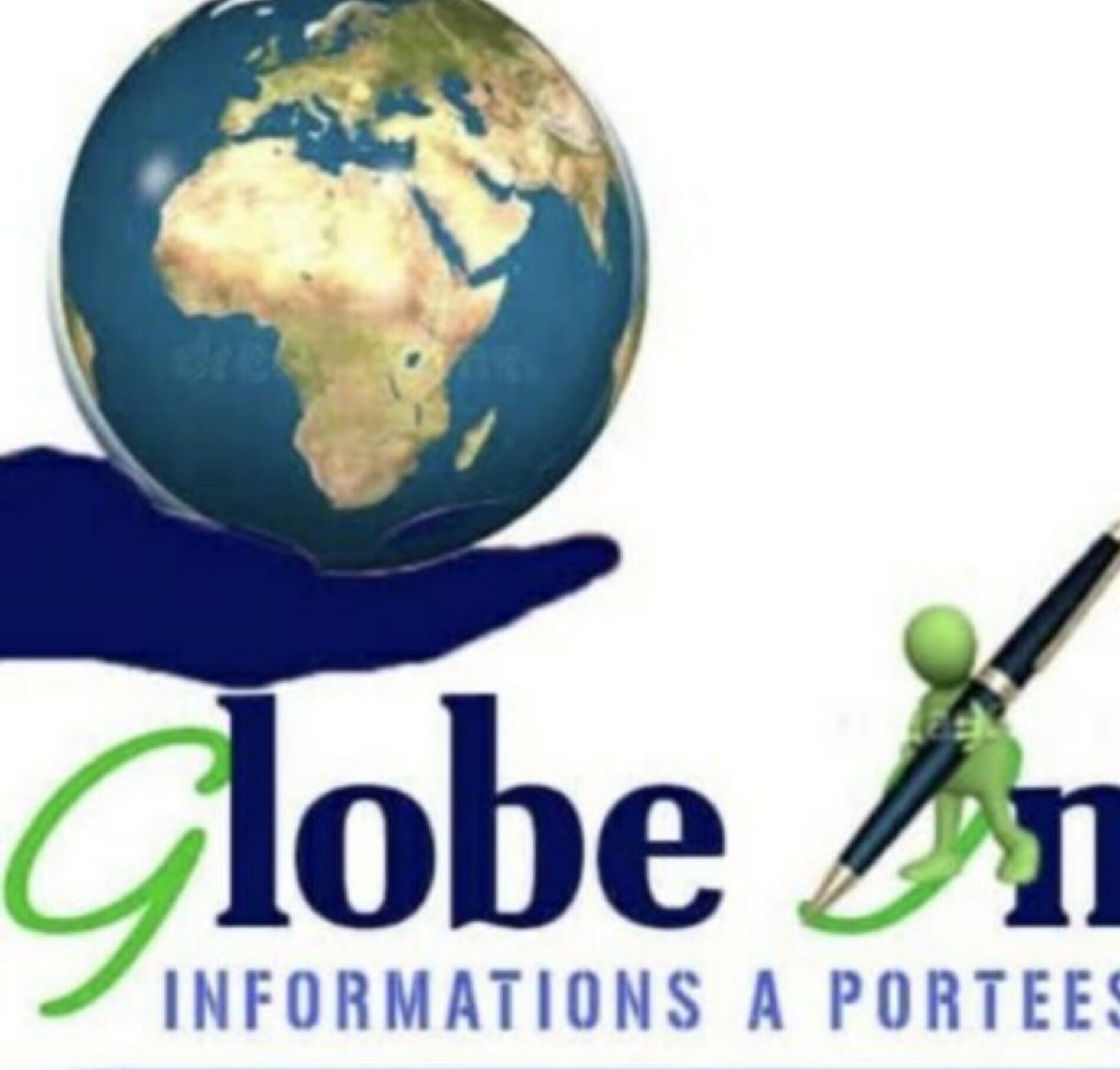Libreville, 25 octobre 2025. Par la rédaction de Globe infos

Au siège du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST), à Libreville, la matinée de ce vendredi 24 octobre a eu des airs de promesse. Autour des chercheurs, des pisciculteurs, des techniciens et des représentants institutionnels, un souffle d’espoir planait : celui d’un Gabon qui entend tirer parti de sa richesse en eau pour bâtir une aquaculture moderne et durable.

En effet, l’événement du jour est : l’inauguration officielle de la Plateforme aquacole de recherche et de développement de l’Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF), fruit d’un partenariat structurant entre le gouvernement gabonais et la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Quand la recherche devient levier de souveraineté
Le premier à prendre la parole fut le Professeur Alfred Ngoma, commissaire général du CENAREST. Face à un auditoire attentif, il a planté le décor d’un projet qui, selon lui, dépasse la simple création d’une infrastructure.
« Cette plateforme est plus qu’un bâtiment : c’est un levier stratégique au service de la souveraineté alimentaire, de l’emploi et de la transformation économique du Gabon », a-t-il déclaré, sous les applaudissements.
Dans un ton à la fois ferme et inspirant, le Pr Ngoma a rappelé la vision du Président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière d’autonomie alimentaire.
« Produire davantage et mieux avec nos propres atouts », a-t-il cité, avant d’ajouter :
« Dans cette trajectoire, la science n’est pas un accessoire. Elle est l’outil premier de la performance. »
Évoquant un paradoxe — celui d’un pays doté d’un potentiel halieutique immense mais dont la production aquacole plafonne encore autour de 45 tonnes par an. Le Commissaire général a appelé à transformer cette faiblesse en moteur de transformation.
« Ce paradoxe n’est pas une fatalité, mais une opportunité d’accélérer. La recherche appliquée est notre clé. »

La FAO en partenaire stratégique du développement durable
Après lui, M. Athman Mravili, coordinateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale et représentant de l’organisation au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe, a salué l’engagement du gouvernement et du monde scientifique gabonais.
« Aujourd’hui, nous célébrons bien plus que l’ouverture d’une infrastructure scientifique. Nous posons ensemble les fondations d’une aquaculture gabonaise moderne, durable et compétitive : une aquaculture capable de nourrir, d’employer et de préserver », a-t-il lancé.
Rappelant que l’aquaculture représente désormais plus de la moitié de la production mondiale de poisson destiné à la consommation humaine, M. Mravili a insisté sur le rôle clé de la science et de l’innovation pour garantir la durabilité du secteur.
La FAO, a-t-il souligné, accompagne cette dynamique à travers son Programme de Coopération Technique, qui a permis la fourniture de souches améliorées de tilapia, d’équipements pour le laboratoire d’hydrologie et d’ichtyologie, et la mise en place d’un cadre de recherche et de transfert de technologies au service du développement.
« La FAO restera un partenaire attentif, disponible et engagé pour faire de cette plateforme un pôle d’excellence au service d’une aquaculture gabonaise performante et durable », a-t-il conclu.

Des résultats scientifiques déjà prometteurs
La visite guidée de la plateforme a permis de constater les progrès déjà enregistrés par les chercheurs de l’IRAF.
Dans le laboratoire de clonage, les expériences menées sur le croisement entre des espèces mâles venues de Tanzanie et des femelles locales affichent un taux de réussite remarquable de 99 %.
Les pisciculteurs actuellement en formation sur le site enregistrent, eux, des taux avoisinant les 76 %, preuve que la technologie de reproduction est déjà transmise avec efficacité.
Mieux encore, les équipes de recherche orientent désormais leurs travaux vers la production d’aliments nutritifs à base de matières premières locales — une innovation qui devrait réduire considérablement les coûts de production pour les acteurs du secteur.
Pour les experts du centre, ces résultats sont « on ne peut plus satisfaisants » et augurent « un avenir meilleur qu’aujourd’hui ».

Une ambition bleue partagée par l’État
Pour M. Serge Anicet Abessolo Mba, directeur de cabinet du ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue, qui représentait Madame la ministre empêchée, ce projet s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie nationale 2022-2025 du secteur.
« Le développement de l’aquaculture constitue un pilier essentiel pour rendre le secteur pêche plus contributif au produit intérieur brut et à la diversification de notre économie », a-t-il affirmé.
Le représentant du ministère a salué la qualité du partenariat entre le CENAREST, l’IRAF et la FAO, avant d’exhorter les équipes scientifiques à une gestion exemplaire de cette infrastructure :
« Nous mettons beaucoup d’espoir dans cet outil. Le ministère restera disponible pour vous accompagner afin qu’il devienne un modèle d’efficacité et d’innovation. »

Une vitrine de la recherche gabonaise
Aux côtés du Pr Ngoma et de M. Mravili, plusieurs personnalités scientifiques ont honoré la cérémonie de leur présence, dont le Pr Zanga Koumba Christopher, directeur de l’IRAF, et Mme Huguette Biloho, chargée du programme FAO-Gabon.
La visite du laboratoire expérimental a permis aux invités de découvrir les installations consacrées à la nutrition, à la reproduction et à la biosécurité piscicole — autant de maillons essentiels pour bâtir une aquaculture performante.
Un cocktail convivial a clôturé la cérémonie, symbole d’une synergie retrouvée entre la recherche, les institutions publiques et les partenaires internationaux.
Le Gabon face à son avenir bleu
À travers ce projet, c’est toute une philosophie qui s’affirme : celle d’un Gabon qui mise sur la science, la coopération et l’innovation pour nourrir sa population, créer des emplois et préserver son environnement.
La Plateforme aquacole de recherche et de développement de l’IRAF n’est pas seulement un laboratoire : elle incarne un choix de société, celui d’un pays résolument tourné vers l’avenir, où la mer et la recherche marchent désormais de concert.
Mots-clés : FAO – CENAREST – IRAF – Aquaculture – Recherche scientifique – Souveraineté alimentaire – Économie bleue – Brice Clotaire Oligui Nguema – Libreville – Gabon – Athman Mravili – Alfred Ngoma – Développement durable